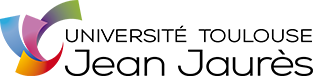-
Partager cette page
5.3. Savoir-faire culturaux et pratiques alimentaires des sociétés médiévales méridionales
Nelly Pousthomis
L’impulsion donnée par Marie-Pierre Ruas, aujourd’hui chercheur à l’UMR 5059, C.B.A.E. mais toujours membre associé à Terrae, a permis de poursuivre les recherches carpologiques sur les aires d’étude de Terrae. Le volet archéobotanique de l’équipe toulousaine des médiévistes est resté actif grâce aux liens conservés avec elle et à l’étudiante qu’elle a formée, C. Hallavant, aujourd’hui ingénieur contractuel associée à Traces. La présence de cette dernière à Toulouse, ses interventions sur de nombreux sites du Sud-Ouest, ses compétences et ses liens avec les médiévistes, ainsi que le contexte favorable à la création d’une Maison de l’Archéologie sur le campus, incitent à poursuivre ce volet des pratiques culturales et des plantes alimentaires. Les études sont transversales : elles incluent les questions relatives aux pratiques agraires, mais s’intéressent aussi aux plantes indicatrices de spécificités régionales, d’identité culturelle, ou encore de statut social. Dans le sillage de recherches conduites sur les Pyrénées catalanes (cf. bilan), puis sur le village castral de Montaillou (Ariège) au XIIIe s., où la question d’une spécificité montagnarde dans l’alimentation et les productions agricoles a été approfondie (Hallavant et Ruas 2009), se dessine une approche comparative couvrant un espace plus large, allant des Pyrénées au Quercy pour lequel des sites implantés dans des zones géographiques et topographiques contrastées et de statuts divers apparaissent. Cette thématique a toute sa place au sein des recherches transdisciplinaires sur la montagne.