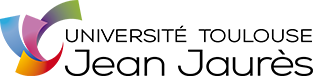-
Partager cette page
5.1 Approche méthodologique et technologique de la vie quotidienne des sociétés médiévales
Une partie de l’activité se situe dans la continuité d’élaboration de corpus et leur diffusion. Les éléments sont désormais réunis pour une publication sur les « Techniques de production et commercialisation de la céramique à l’époque moderne : le groupe de Cox » (J.-M. Lassure, manuscrit prévu fin 2010). L’élargissement de l’opération « la céramique du Bas Moyen Âge à Toulouse » (J. Catalo) devrait permettre d’estimer l’influence du modèle toulousain sur le plan régional, et au-delà avec des corpus extra-régionaux, dans une opération renommée « La céramique du bas Moyen Âge en Midi-Pyrénées ».
Du côté du mobilier métallique, les objectifs assignés à l’opération « Typochronologie des objets en alliage cuivreux entre Aquitaine et Méditerranée (XIe-XIVe s.) » comportent les compléments et mise à jour du corpus existant en Midi-Pyrénées, un inventaire détaillé en Limousin, des approches par sites en Aquitaine et Languedoc occidental. Il s’agira également de poursuivre la numérisation du catalogue et de réaliser plusieurs publications, dans le cadre de monographies de sites en préparationcomme Châlucet (Haute-Vienne), Fenouillet (Pyrénées-Orientales), Muséum de Toulouse (Haute-Garonne), Montréal-de-Sos (Ariège), et une synthèse sur le mobilier mérovingien de Tabariane (Ariège). Outre la publication de monographies de sites ou d’études de trésors et la poursuite des inventaires, un projet d’ANR « numismatique médiévale » est en cours de préparation par F. Dieulafait (TRACES), coord. Michel Feugère, Michel Py (UMR 5140) : conception de trois Dictionnaires - outils de référence typologiques – numismatiques des monnaies pré-augustéennes aux monnaies féodales et royales (F. Dieulafait) ; l’ambition est de livrer aux archéologues un outil de typologie normalisée et de classement général, en version papier ouélectronique (Mac/PC etInternet), avec la collaboration de chercheurs de cinq laboratoires CNRS et deux organismes étrangers. Un workshop scientifique (Allemagne, France, Suède, Norvège, Danemark et Russie), autour du trésor d’or de Hiddensee et l’art du filigrane et de la granulation Viking, aura lieu en 2010 au musée de Stralsund (Kulturhistorisches Museum Stralsund). Un projet de recherche (franco-russe) sur l’outillage (en fer, en bronze, en céramique, en pierre) de l’orfèvre et du bronzier du haut Moyen Âge est prévu, de 2010 à 2013, en collaboration avec Natalja Eniosova de l’Université d’Etat, le Musée Historique Moscou et le Musée de l’Ermitage. Cette étude comparative portera sur les vestiges d’ateliers et de tombes d’artisans en Scandinavie et dans l’ancien Russie (Gnezdovo, Novgorod et Staraja Ladoga). La technologie, l’iconographie et la symbolique de l’orfèvrerie de la période des migrations au nord de l’Allemagne et en Scandinavie seront au centre d’un projet de recherche en collaboration avec Alexandra Pesch (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, ZBSA) à Schleswig, en 2011-2014. L’orfèvrerie anglo-saxonne sera abordée au travers des fibules penannulaires du type « Tara » du VIIIe siècle ; les deux grandes fibules énigmatiques en argent partiellement dorées, la « Hunterston brooch » du National Museum of Scotland, et la « Tara brooch » du National Museum of Ireland et des pièces comparables du British Museum à Londres, seront examinées en collaboration avec Niamh Whitfield (Londres), et Frazer Hunter et Jim Tate (Edinburgh), pour cerner leur facture particulièrement complexe (2011-2013). Des liens ont déjà été noués avec d’autres unités spécialisées en archéométrie, comme l’Iramat de Bordeaux, de Belfort, et le CEA à Saclay ; ils permettront de coordonner les études typologiques et technologiques. L’archéologie expérimentale reste un point important pour la compréhension de la métallurgie du haut Moyen Âge. Des expérimentations pratiques et des documents graphiques sur les résultats seront réalisés dans le cadre de workshops avec des étudiants et des collègues (2010-2014), comme, en 2009 et 2010 pour la publication de la nécropole de Tabariane (Ariège), prévue par B. Armbruster et N. Portet. Ce volet expérimental, en particulier dans les arts du métal, doit être développé. La réflexion s’est aussi largement engagée sur la valorisation des collections archéologiques en partenariat avec les collectivités locales et les musées. Cette première doit se concrétiser dès 2010 avec l’ouverture d’un centre d’interprétation sur la période mérovingienne à Mazères (Ariège), espace qui présentera la nécropole de Bénazet et ses collections archéologiques.